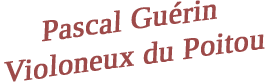Origines

Je suis originaire de Moncoutant, en bocage «Bas Poitevin», territoire à cheval sur le nord du département des Deux-Sèvres et le nord de la Vendée, séparés par la Sèvre nantaise, véritable artère de ce pays, théâtre d’une histoire assez mouvementée. On parle aujourd’hui communément de bocage bressuirais, du nom de la ville historique principale de cette partie deux-sèvrienne. C’est au lieu-dit «La Bleure» que j’ai passé mon enfance jusqu’à mon adolescence, avant de partir pour le lycée à Poitiers.
Si je mentionne ce détail, important à mes yeux, c’est qu’il me semble que c’est à cette période que s’est mis en place tout un ensemble d’éléments qui ont favorisé par la suite ma sensibilité, mon intérêt pour ce domaine particulier des musiques traditionnelles et plus largement mon implication associative à venir dans la culture régionale.
La famille

Pour commencer, j’avais un grand-père maternel, pépé «Nonone», surnom d'André, Noël Fradin (1874-1970) qui a vécu veuf chez moi et que j’ai côtoyé jusqu’à sa fin de vie (j’avais alors 14 ans et lui 96).
Personnage haut en couleurs, très joyeux luron qui ne parlait pas un mot en français, mais qui s’exprimait dans sa langue maternelle poitevine ; il avait très peu fréquenté l’école pour garder les vaches dès 9 ans...
J’ai donc été en quelque sorte « biberonné » au poitevin, au point de me faire ridiculiser par ma première maîtresse de maternelle lorsqu’une fois je m’étais exprimé naturellement dans cette langue qualifiée alors de « patois » ! Dur pour démarrer en confiance ! Mais les liens familiaux étaient plus forts, le mode d’expression dans mon entourage proche restait encore très marqué par la langue régionale.
Autre élément pas complètement anodin : la présence, dans la maison mitoyenne de mes parents, d’une famille cousine, dont Abel Fradin (1896-1978), agriculteur à la retraite, qui possédait un violon et le sortait à l’occasion pour en jouer, par loisir, car il n’avait jamais été musicien de noces. Ce fut alors mon tout premier contact avec l’instrument, qui me paraissait d’ailleurs très étrange et même bizarre avec cet archet dont je ne saisissais pas vraiment la fonction.
Pour moi, enfant, la production d’un son avec cet «objet» tenait presque de la magie et restait très obscure et mystérieuse! Et c’est aujourd’hui sur ce même instrument (entre autres) que je joue puisque j’ai eu l’heureux privilège d’en être « l’héritier » cinquante ans plus tard.
Education populaire

Après des débuts à la guitare, avec des frères et sœur aînés qui s’y essayaient aussi en suivant l’actualité de la chanson des années 1960, des séjours en colonies de vacances, en camps, où la pratique du chant était assez dense, un rapide séjour à l’école de musique et la participation à un atelier au collège de Bressuire, je me retrouve, avec mes copains de l’époque, à participer à des activités de danses folkloriques au Club des jeunes de Moncoutant à la fin des années 60 - début des années 70, motivé par la convivialité des rencontres avec les gars et, ne soyons pas dupes, les filles de mon âge...
C’est ainsi qu’en 1971, avec l’association locale de Cerizay-Moncoutant L’Avant-deux du bocage, je participe, lors des vacances de février, à l’un des stages Opération Sauvetage de la Tradition Orale Paysanne, dits OSTOP, initiés en Poitou-Charentes par un des premiers fervents défenseurs des cultures paysannes, André Pacher (1932-1996), alors fondateur de l’UPCP (Union Pour la Culture Populaire en Poitou-Charentes et Vendée) et des Ballets populaires poitevins.
André Pacher est relayé en bocage par Jany Rouger, déjà fortement impliqué dans ce mouvement. Ensemble, ils feront aboutir plus tard le projet de la Maison des Cultures de Pays à Parthenay.
Les débuts au violon

Ce premier stage, qui a lieu à l’école publique de Cirières (hasard ou fatalité, c’est ma commune de résidence actuelle), me fait étonnamment reprendre contact avec le violon, que je redécouvre sous un nouvel angle grâce à un des stagiaires.
André Pacher a emmené avec lui un élève du lycée agricole où il est animateur à l’époque, surnommé Chailloune, membre d’un autre groupe de l’UPCP, La Marchoise. De son vrai nom Bernard Guyot, il a déjà commencé la pratique à l’oreille d’un instrument traditionnel, l’accordéon diatonique, qu’il tenait de son grand-père, et l’a apporté avec lui.
Après des soirées endiablées de «boeufs» musicaux à vouloir maîtriser un son sur un violon emprunté, un début de passion semble s’installer, nourrie par une sorte de défi lié à la difficulté d’exécution...
C’est le début d’une aventure qui commence, et je ne serai jamais assez reconnaissant envers Chailloune!
Constatant mon emballement un peu précipité, André et Jany, de concert, me pressent de me mettre à l’école de Paul Micheneau (1904-1998), ancien violoneux de bal et de noces, lequel, qui plus est, habite le lieu-dit Les Places à Moncoutant, à peine à un kilomètre de mon domicile. Me voilà des samedis après-midi entiers, au retour du collège, avec un violon prêté par une cousine éloignée, à enfourcher mon vélo, parfois le Vélosolex de ma sœur, direction le chemin des Places, que je connais par cœur puis- qu’emprunté dès l’enfance avec pépé Nonone pour cueillir les noisettes, belle continuité du destin !
Chez Paul

Chez Paul, c’est l’immersion, à commencer par la révélation des liens familiaux : cousin par ma mère, lorsqu’il me fait travailler son quadrille, et qu’il me parle de l’Avant-deux à tonton Gust’ (Auguste Baudu, 1865-1946, grand-oncle maternel violoneux), il m’explique la généalogie, la filiation.
Pour tel air, qu’il a appris de Bourdounau (Maximin Billaud 1879- 1930), il m’explique les circonstances d’apprentissage.
C’est ainsi que lors de mes premiers pas sur scène dans le spectacle de L’Avant-deux du bocage, j’ai l’immense privilège d’être présenté comme « l’apprenti Bourdounau du Conservatoire des Places».
À n’en pas douter c’est la célébrité assurée, surtout que je n’ai pas beaucoup de concurrents prétendant à ce titre ! «Quoi? me dit d’un air grave une copine du collège, élève pianiste à Bressuire, tu apprends le violon sans les notes, d’oreille ? Comment tu fais ? »
Le pouvoir des rencontres

C’est évidemment par l’enchaînement des rencontres qui vont suivre avec les nombreux violoneux encore présents en bocage, à l’occasion des stages avec l’Arcup (Animation Rurale et Culture Populaire en Bocage, nouveau nom de l’association qui remplacera celui d’Avant-deux du bocage) ou en dehors, que va s’ancrer ma pratique du violon traditionnel.
En 1975, la présence des Frères Balfa, musiciens de Louisiane en tournée en France avec Roger Mason, lors d’un stage UPCP à L’Absie (79), crée un certain choc : tout en mesurant la distance culturelle, je réalise la parenté avec nos musiques «originales de pays », d’autant plus que l’échange est facilité par la langue française, avec sa riche tonalité créole.
Etudiant et disponible, je n’hésiterai pas un instant lorsqu’en juillet 1976, à l’occasion du bicentenaire des Etats-Unis, John Wright et Catherine Perrier, responsables d’une tournée aux USA, me proposent de participer, pour représenter le violon du Poitou, au Festival of American Folklife.
Nous y rencontrerons d’autres violoneux cajuns, mais aussi québécois, de musique bluegrass... Chanteurs et chanteuses, musiciens et musiciennes, danseurs et danseuses représentant plusieurs régions de France étaient bien sûr présents dans cette délégation (Auvergne, Bretagne avec Erik Marchand, groupe de chant béarnais, Alsace, Gascogne avec l’accordéoniste Léa Saint-Pé...).

Nuit de la St-Jean à la Marandière (197?) avec Paul Micheneau, Pascal Guérin, André Morisson de la Marchandelle, Jany Rouger ©Arcup
De telles rencontres laissent forcément des traces qui marquent à jamais ! Mon regard sur le violon va alors s’élargir en réalisant la pluralité des traditions dont il est porteur. Car non seulement reconnu comme un des instruments-phares des musiques dites « savantes », il devient à mes yeux un des plus grands ambassadeurs des traditions musicales dans les musiques du monde.
Une vie en musique

La suite, c’est l’histoire de l’Arcup (cf. Cinquante ans de culture populaire en bocage, l’Arcup, de la Marandière à Cerizay, éd. La Geste, 2020), où je deviens permanent en 1981 : continuation de la recherche et documentation, poursuite de l’édition de la série de disques Violons du bocage, préparation des spectacles d’été Nocturnes à la Marandière (ancienne ferme devenue le siège social de l’association), animations scolaires, ateliers de violon...
En 1993, une transition s’opère avec la création au niveau national des « départements de musique traditionnelle».
Après des années d’enseignement en milieu associatif, je rejoins le Conservatoire de musique à rayonnement intercommunal de l’Agglomération du bocage bressuirais, ainsi que les écoles de musique de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine et de la Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie (Vendée).
Plusieurs rencontres musicales autour du violon auront lieu dans ces nouveaux contextes : jazz, musique Renaissance, musiques traditionnelles d’Europe (voyages en Roumanie, en Irlande...).
En parallèle de l’enseignement «officiel», après avoir eu l’occasion de goûter aux musiques cajuns de Louisiane, québécoises, old time, bluegrass, pendant presque deux décennies, nous avons constitué, avec une bande de copains, un groupe de country-rock, les West Boys, comprenant basse, batterie, guitares électrique et acoustique, banjo, violon, chant...
Aventure différente du bal trad poitevin, très intense, un peu folle parfois mais très enrichissante.
Aujourd'hui

Depuis 2018, retraité, je poursuis ma participation au groupe de chant traditionnel Guillannu de l’Arcup, matérialisant plus de cinquante ans d’amitiés et, sur le plan instrumental, afin de nourrir ma curiosité pour d’autres univers musicaux, je participe, au violon, à l’Ensemble de musique ancienne du Conservatoire de musique du bocage bressuirais : mais attention, on joue avec les notes! (vieux compte à régler avec la lecture musicale...).
Comme disait mon beau-père Michel Merlet (1930-2020), clarinettiste à l’harmonie municipale de Cerizay, en réponse à un jeune chef lui reprochant quelques « fausses notes » : « Je ne fais peut-être pas tous les dièses et les bémols, mais je joue juste ! » ... À méditer !