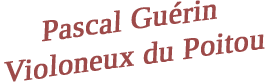Un mariage en 1926, avec Paul Micheneau au violon ; en bas à gauche, Ernest Pérochon (1885-1942), écrivain local, prix Goncourt 1920, avec son épouse ; juste devant, la jeune fille en tenue blanche à côté : ma mère Alcine Fradin (1914-2008) à 12 ans.
Un mariage en 1926, avec Paul Micheneau au violon ; en bas à gauche, Ernest Pérochon (1885-1942), écrivain local, prix Goncourt 1920, avec son épouse ; juste devant, la jeune fille en tenue blanche à côté : ma mère Alcine Fradin (1914-2008) à 12 ans.
En enregistrant cet album, j’avais en mémoire des traits à la fois singuliers et communs du jeu des violoneux, rencontrés lors des nombreuses enquêtes de terrain.
Par exemple, l’efficacité de l’entraînement à la danse, du mouvement : tout l’art du jeu dépend de ces facteurs.
On rencontre parfois des phrases mélodiques asymétriques, alors que les formes, les structures de la danse sont pourtant assez régulières.
Le danseur doit alors s’adapter, et c’est le rythme (la fameuse «cadence» dont parlent tous les violoneux) qui porte, qui « soulève » le pied du danseur.
Même s’il y a une exigence pour l’agilité de la main gauche, la justesse ne se situe pas que dans «les notes» ou les hauteurs (utilisation parfois de modes avec échelles à tempéraments inégaux), il ne faut surtout pas négliger la main droite, celle de l’archet : « le bras droit est celui qui dit la musique» (cf. Ami Flammer, violoniste, enseignant au CNSMD de Paris, La Lettre du Musicien, décembre 2008-n°366, croisé aux rencontres Coups d’Archets à Châteauroux en 1993), phrase qui résume à elle seule certaines bases de la technique, valables aussi bien pour le « traditionnel » que pour le « classique ».
 Cerizay (79), 22 juillet 1978, Auberge du Cheval Blanc. Alfred Talon au violon menant 2 couples de mariés
Cerizay (79), 22 juillet 1978, Auberge du Cheval Blanc. Alfred Talon au violon menant 2 couples de mariés
Dans le disque présent comme chez les violoneux, l’accord de l’instrument est fluctuant, parfois un demi-ton voire un ou deux tons plus bas que la hauteur de référence actuelle et bien que respectant des quintes, une ou deux cordes graves peuvent se retrouver en bourdon à l’octave, la mélodie restant la colonne vertébrale.
Une caractéristique du violoneux (paysan, artisan, petit commerçant, cafetier, journalier, occupant la fonction musicale dans la société rurale comme activité complémentaire), c’est qu’il anime un bal, une veillée ou une noce la plupart du temps seul, rarement en duo, ou en trio, très exceptionnellement avec des instruments tempérés tels les vents (à anches, à embouchures ou à touches) ; donc il est très libre dans l’accordage, le tempérament, la cadence, dans l’animation parlée de la danse.
L’essentiel est qu’il donne du son! On disait d’ailleurs un «sonneur de violon»...
C’est «l’esprit rock» avant l’heure en quelque sorte, et c’est bien là ce qui constitue sa « modernité ».
Pascal GUÉRIN